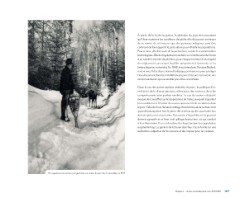Page 25 - Le parc des Laurentides
P. 25
À partir de la fin de la guerre, la direction du parc est consciente
qu’il faut maintenir les conditions de pêche afin de pouvoir continuer
de se vanter de n’y trouver que des poissons indigènes sans être
contraint de faire appel à la pisciculture pour rétablir les populations.
Pour ce faire, elle doit ouvrir de nouveaux lacs, comme le recommandent
les biologistes. Elle doit également maintenir un contrôle serré de l’accès
à un nombre restreint de pêcheurs pour chaque territoire et du respect
des règlements concernant la pêche uniquement à la mouche et les
limites de prises autorisées. En 1948, le surintendant, Gustave Bédard,
revient avec l’idée d’une station biologique permanente pour protéger
l’investissement dans les installations du parc et assurer son avenir, une
recommandation qui ne semble pas s’être concrétisée.
Dans le cas des autres espèces animales du parc, la politique d’in-
terdiction de la chasse persiste, même pour des animaux dont les
comportements sont parfois nuisibles. Le cas du castor a déjà été
évoqué dans ses effets sur les populations de truites, auxquels s’ajoutent
les inondations et l’érosion des routes qui nuisent à la circulation dans
le parc. Celui de l’ours demeure ambigu dans la mesure où certains sont
quasi domestiqués et font le plaisir des visiteurs qui les nourrissent lors
de leurs présences récurrentes. Par contre, s’ils prolifèrent, ils peuvent
devenir agressifs et se livrer à du pillage destructeur, ce qui conduit
à leur élimination. Il en est de même des loups lorsque leur population
augmente trop. La gestion de la faune dans leur cas se fonde sur une
évaluation subjective de la nuisance et des risques pour les visiteurs.
Un raquetteur rencontre un orignal dans un sentier du parc des Laurentides, en 1947
Chapitre 3. Un parc accessible par la route, 1930-1960 127
qu’il faut maintenir les conditions de pêche afin de pouvoir continuer
de se vanter de n’y trouver que des poissons indigènes sans être
contraint de faire appel à la pisciculture pour rétablir les populations.
Pour ce faire, elle doit ouvrir de nouveaux lacs, comme le recommandent
les biologistes. Elle doit également maintenir un contrôle serré de l’accès
à un nombre restreint de pêcheurs pour chaque territoire et du respect
des règlements concernant la pêche uniquement à la mouche et les
limites de prises autorisées. En 1948, le surintendant, Gustave Bédard,
revient avec l’idée d’une station biologique permanente pour protéger
l’investissement dans les installations du parc et assurer son avenir, une
recommandation qui ne semble pas s’être concrétisée.
Dans le cas des autres espèces animales du parc, la politique d’in-
terdiction de la chasse persiste, même pour des animaux dont les
comportements sont parfois nuisibles. Le cas du castor a déjà été
évoqué dans ses effets sur les populations de truites, auxquels s’ajoutent
les inondations et l’érosion des routes qui nuisent à la circulation dans
le parc. Celui de l’ours demeure ambigu dans la mesure où certains sont
quasi domestiqués et font le plaisir des visiteurs qui les nourrissent lors
de leurs présences récurrentes. Par contre, s’ils prolifèrent, ils peuvent
devenir agressifs et se livrer à du pillage destructeur, ce qui conduit
à leur élimination. Il en est de même des loups lorsque leur population
augmente trop. La gestion de la faune dans leur cas se fonde sur une
évaluation subjective de la nuisance et des risques pour les visiteurs.
Un raquetteur rencontre un orignal dans un sentier du parc des Laurentides, en 1947
Chapitre 3. Un parc accessible par la route, 1930-1960 127